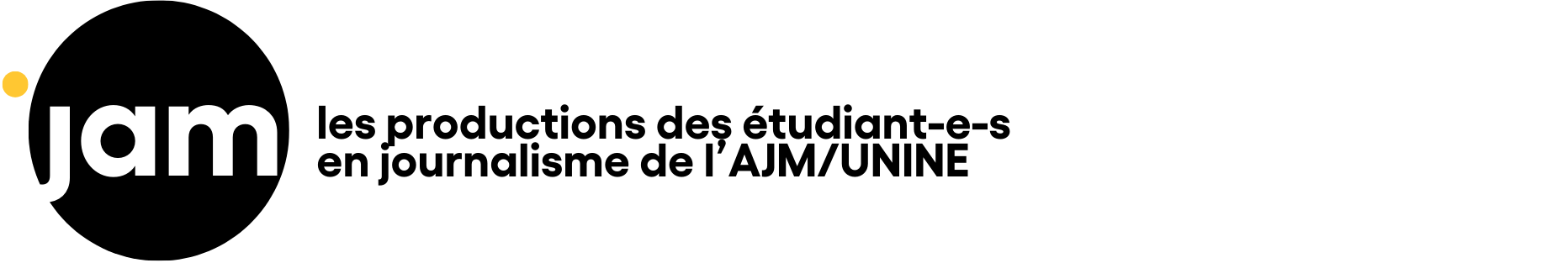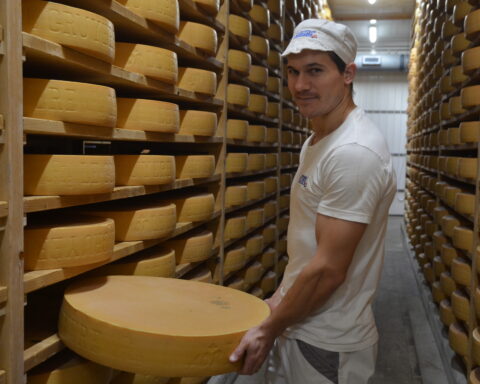Le centre de formation de l’ASF à Bienne façonne les futures stars du football féminin suisse. Mais exigences élevées et perspectives limitées, la question d’un départ à l’étranger finit par se poser.
Elles ont 14 ou 15 ans et deviendront la crème du football féminin suisse. C’est du moins la promesse que semble formuler le centre de formation de l’Association suisse de football, implanté à Bienne depuis 2012. « C’est un centre important pour promouvoir les jeunes talents », confirme le chargé de communication de l’association. Et pour cause, la structure est la seule en son genre dans le pays.
Sélectionnées à travers toute la Suisse, à partir de leurs 12 ans, les jeunes filles sont soumises à un programme chargé. Entraînements quotidiens et temps consacrés à l’école se combinent dans leurs semainiers. À la clé? Des débouchés pour la suite de leurs carrières. « On peut aussi être recrutées en club, mais ici, c’est vraiment un centre de formation, donc il y a un côté plus international », constate Linda.
A 14 ans, la footballeuse s’entraîne au Lausanne-sport « avec les garçons » et rêve d’évoluer à l’Olympique lyonnais au terme de sa formation. «Le niveau est haut ici, on peut bien s’améliorer», appuie Louise, qui vise plutôt Arsenal ou Barça, comme beaucoup de ses coéquipières. Mais le haut niveau promis par le centre a un prix: « On n’a presque pas de temps libre ». Un emploi du temps qui pousse certaines joueuses à s’imaginer plutôt sur pelouse helvétique. « L’année prochaine, j’aimerais rester tranquille, avec ma famille, parce qu’on n’a pas beaucoup d’occasions de les voir ici », confie Solaya qui joue au FC Zurich.
Une voie plus proche de celle des hommes
Faudrait-il plutôt partir à l’étranger pour réussir sa carrière? « Personnellement, en sortant de l’école obligatoire, rester quelques années en Suisse m’a beaucoup aidée », explique Sandrine Mauron, ancienne milieu de terrain de Servette Chênois qui a aussi connu près de 60 apparitions dans le championnat allemand. « Mes premières années en Super League ont été un tremplin vers l’étranger. »

Elle a fait ses débuts en Super League en 2012, alors qu’elle n’avait pas encore 16 ans, jouant toute la saison parmi les titulaires avec Yverdon. Mais la situation du football suisse a beaucoup évolué depuis, et obtenir une telle place à cet âge est aujourd’hui plus complexe.
Sur les 26 joueuses appelées en équipe nationale M19 cette saison, un peu plus de la moitié (14) sont déjà intégrées à une première équipe en Suisse, et seules cinq d’entre elles ont disputé plus de 50 % des minutes en championnat. C’est beaucoup moins que les 13 joueuses titulaires au même âge lors de la saison 2013-14, la première de Sandrine Mauron. À l’époque, pas moins de 20 joueuses sur 23 étaient déjà intégrées dans un club suisse de première division.
« C’est une suite logique », explique Sandy Maendly, ancienne joueuse et directrice sportive du Servette FC. « Aujourd’hui, les joueuses passent plus souvent par les sélections M20, ou la ligue nationale B, avant d’intégrer les premières équipes de Super League. »
Un parcours plus proche de celui des hommes, qui reflète les améliorations du système. Comme le rappelle Sandy Maendly, il y a encore quelques années, on s’entraînait beaucoup moins à cet âge, et avec des personnes moins compétentes qu’aujourd’hui. « Les cours de formation d’entraîneurs proposés par les cantons et l’Association suisse de football sont de grande qualité, poursuit Sandy Maendly. Et si l’on compare la taille du pays au nombre de joueuses que la Suisse est capable de produire, on a la preuve du haut niveau de formation. »
« À l’étranger, on est un chiffre«
S’il est fascinant de partir à l’étranger, ce n’est pas sans risque. Les joueuses talentueuses sont assurées d’avoir leur place dans les équipes de Super League, mais il n’en va pas de même ailleurs, où la concurrence est plus rude. « À l’étranger, on devient une joueuse parmi d’autres, un chiffre », explique la Genevoise. « Au contraire, ici, on en prend un peu plus soin, car chaque club aimerait que ses talents jouent dans l’équipe nationale, ou partent dans une équipe européenne de renom. »
Sandy Maendly sait de quoi elle parle, grâce à son expérience internationale accumulée au cours des sept dernières années dans des ligues étrangères, entre l’Italie et l’Espagne. « Nous sommes encore considérés comme un petit pays de seconde zone, ce qui fait qu’une joueuse suisse n’a pas le même poids que celle d’une autre nationalité. »

Son conseil est donc clair: « Je privilégierai toujours de terminer sa formation en Suisse, plutôt que de partir trop tôt à l’étranger, avec des bases qui ne sont pas encore là. »
Partir plus tard
Si le système s’est amélioré sur le plan sportif et permet aux joueuses de se développer dans un environnement approprié, en dehors du terrain, des progrès restent à faire. Comme l’explique Sandy Maendly, il n’est pas toujours facile de concilier le football avec les études. « Il faut penser à des aménagements », prévient celle qui est aujourd’hui à la tête du projet « Héritage », visant à développer le football féminin dans le canton de Genève.
En sortant du contexte junior, d’autres problèmes émergent. « Si l’on vise le professionnalisme, la Super League féminine n’est certainement pas le meilleur championnat, explique Sandrine Mauron, qui a quitté Servette Chênois à la fin de la saison, pour repartir à l’étranger. Nous n’avons pas de salaire minimum, ni d’accès à la totalité des soins nécessaires à un athlète de ce niveau. » Alors oui, en grandissant, il vaut mieux partir.
Les revenus des footballeuses
Selon le dernier rapport annuel de la FIFA, sorti en mars 2025, le salaire annuel moyen d’une joueuse de football professionnelle dans le monde s’élève à 10’900 dollars, et à 24’000 dollars pour les équipes qualifiées par la FIFA de niveau 1, à savoir les clubs ayant le plus haut niveau de professionnalisation (groupe auquel n’appartient aucune des équipes suisses). Et le chiffre monte jusqu’à 120’000 dollars pour le salaire le plus élevé. En Suisse, selon une enquête de Blick sur 67 joueuses de la Super League en 2022, leur salaire annuel moyen atteignait 4500 francs , sachant que plus de la moitié d’entre elles ne sont pas professionnelles. A noter que les joueuses ayant répondu à leur questionnaire, comme le souligne Blick, sont probablement celles avec le salaire le plus bas.
Par Antonio Fontana, Coline Grasset et Nina Devaux
Ce travail journalistique a été réalisé pour le cours « Pratiques journalistiques thématiques » dans le cadre du master en journalisme de l’Académie du journalisme et des médias (AJM) de l’Université de Neuchâtel.Une version de cet article a été publiée dans 24 Heures le 2 juillet 2025.