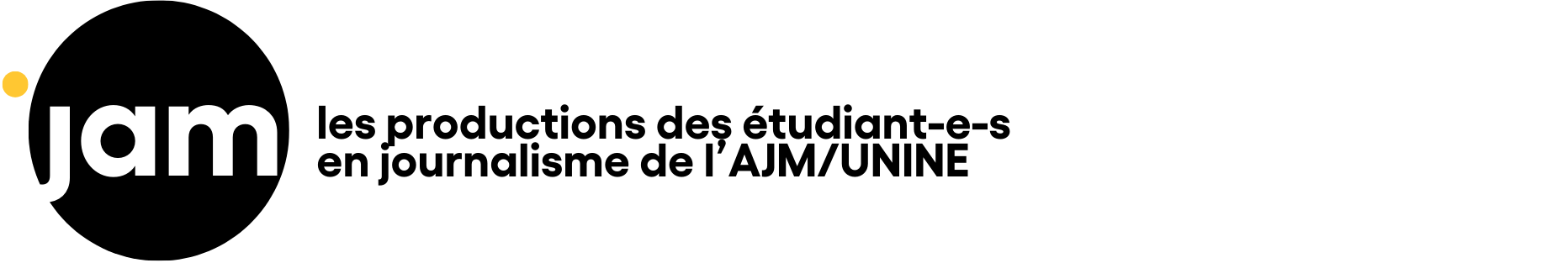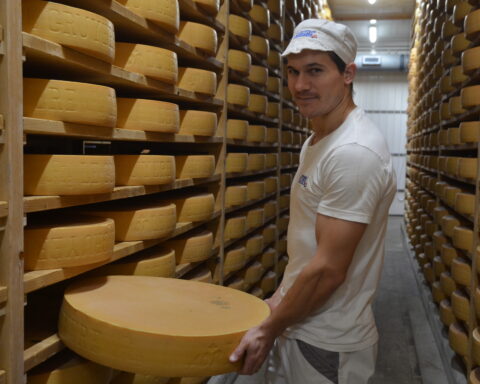Alors que l’Euro 2025 braquera les projecteurs sur l’équipe nationale féminine A, qu’en est-il des espoirs et des craintes de la relève? Rencontre avec les M15 de l’Association Suisse de Football (ASF), qui s’entraînent au centre de formation national à Bienne.
Nous arrivons à la Tissot Arena, guidés vers une grande salle sans fenêtre, habituellement réservée aux devoirs. Aujourd’hui, elle est calme. Les jeunes footballeuses vont bientôt nous rejoindre, avant leur entraînement. Quand elles entrent, souriantes mais pressées, on ressent tout de suite le tempo de leur quotidien: millimétré, intense, sans pause superflue. Trente minutes, pas plus, pour échanger. Dans leurs regards, une détermination silencieuse. Nous ne sommes qu’une étape de plus dans leur journée rythmée.
Âgées de 12 à 15 ans, les 21 jeunes joueuses ont toutes une histoire singulière avec le ballon rond. Pour certaines, le coup de foudre a eu lieu très tôt. « J’avais trois ou quatre ans, on regardait la finale de la Coupe du monde 2014. J’ai tout de suite voulu commencer le foot, mais ma mère ne m’a pas crue au début », sourit Amélie Zörgiebel. Un an plus tard, elle rejoignait son premier club. Pour d’autres, comme Elena Schlatter, la passion s’est transmise naturellement dans le cercle familial: « Je jouais pendant les vacances avec mes frères et sœurs, puis j’ai rapidement intégré une équipe. »
Pour ces adolescentes, le football n’est pas qu’un loisir: c’est un projet de vie. Lorsqu’une opportunité d’intégrer le centre de formation national à Bienne s’est présentée, la décision a été évidente pour la plupart. « C’était une évidence », affirme Elena. D’autres ont hésité avant de se lancer: « Au début, je ne voulais pas y aller. Mais mes parents et mes entraîneurs m’ont convaincue. C’est une chance unique, ce genre d’opportunités n’arrive pas souvent », confie Amélie.
Les joueuses ont bataillé pour rejoindre ce centre d’excellence, mais elles le savent, elles ne seront pas toutes sélectionnées pour jouer professionnellement.
Une nouvelle vie pour les joueuses

Avant d’arriver à l’ASF, les jeunes joueuses de la relève doivent quitter leur ville pour s’installer à Bienne. Nouveau foyer, nouvelle école: les repères changent, et l’adaptation varie d’une personne à l’autre. « Au début, c’est compliqué, mais ça dépend des personnes. Certaines s’habituent plus vite que d’autres. En tout cas, moi, je me suis vite adaptée », confie Louise Schüle.
Leur quotidien suit une cadence bien réglée. Déjeuner en famille d’accueil le matin, école toute la matinée, dîner, puis entraînement intensif l’après-midi. Après les exercices, une douche, un peu de temps libre, puis le souper et le coucher. Des journées organisées au millimètre, mais qui plaisent à certaines filles: « Au moins, les journées passent vite. On a moins d’école que les autres et on n’a jamais cours l’après-midi! », se réjouit Zoe Klenk.
Pour gérer la pression, chacune trouve ses propres solutions. « Je pense à des choses positives qui me sont arrivées ou qui vont arriver. Je ressens quand même la pression, bien sûr, mais ça m’aide », explique-t-elle. Le week-end, elles rentrent chez elles pour retrouver leurs familles et, pour la plupart, continuer à jouer avec leur club. Entre routine et compétitions, ces jeunes talents forgent déjà leur mental de championnes.
Des liens forts et des défis d’intégration
Dans ce cadre unique, des liens se tissent. Une forme de sororité naît, renforcée par les défis partagés. Mais l’expérience n’est pas toujours rose. « Quand on n’est pas bien, qu’on a besoin de nos parents et qu’ils ne sont pas là, c’est dur. On peut parfois se sentir seule », admet Zoe. Les relations ne sont pas toujours simples: « On rigole beaucoup, mais pas avec tout le monde », glisse Kenissa Blaser, en soulignant les difficultés d’intégration pour certaines.
L’expression du « Röstigraben » se retrouve dans les relations entre joueuses. Les Romandes et les Alémaniques fréquentent des écoles différentes, ce qui réduit les occasions de se côtoyer au quotidien. Malgré la barrière linguistique, des amitiés se forment, même si les liens entre les deux groupes restent souvent moins forts.
Le but, si on perce, c’est de devenir des modèles pour les autres petites filles.
Kenissa Blaser
Faire évoluer la vision du football féminin
Les jeunes joueuses rêvent grand. Toutes partagent le même objectif: vivre un jour du football. Mais elles le savent déjà, ce rêve a peu de chances de se concrétiser en restant en Suisse. « Même si on réussit ici, même si on devient pro, on ne sera pas connues », résume Kenissa Blaser, consciente des limites actuelles du championnat helvétique féminin. Pour espérer percer, beaucoup envisagent déjà un départ à l’étranger, dans des pays où le football féminin est davantage valorisé, médiatisé, professionnalisé.
Cette ambition est d’autant plus forte qu’elles ont grandi sans véritable modèle féminin auquel s’identifier. Étant petites, elles se comparaient à Messi ou Ronaldinho. Aujourd’hui, des icônes comme Alexia Putellas, double Ballon d’Or et star du FC Barcelone, commencent à changer la donne. Et Kenissa voit plus loin: « Le but, si on perce, c’est de devenir des modèles pour les autres petites filles. »
Derrière leur passion, une autre réalité émerge: celle d’un sport encore perçu comme masculin. Nombreuses préfèrent s’entraîner avec des garçons, pour progresser plus vite puisque l’intensité est plus élevée. Mais s’entraîner avec les garçons n’est pas toujours simple, notamment pour l’ambiance. « Je ne m’attendais pas à toutes ces critiques juste parce que j’étais une fille. En plus, j’ai les cheveux courts », raconte Kenissa. Avant d’ajouter avec détermination: « J’ai envie de réussir pour leur prouver qu’ils avaient tort. »
Le regard de Sandy Maendly sur les rêves des jeunes générations
Sandy Maendly a longtemps porté les couleurs de la Suisse, mais aussi celles de clubs étrangers. À ses yeux, le chemin jusqu’à la pleine reconnaissance du foot féminin reste long, malgré certains progrès qu’elle souligne: « On l’a vu encore récemment avec la finale des play-off à Berne, avec plus de 10 000 personnes. On arrive à mobiliser des gens et il y a toujours plus de personnes intéressées dans le foot féminin. Mais il faut encore travailler pour améliorer ça. »
L’Euro 2025 est une opportunité à ne pas manquer selon elle. Il faudra préparer les structures, pérenniser l’engouement et miser sur la jeunesse. Car si l’avenir du football féminin passe par la relève, encore faut-il lui offrir des perspectives concrètes pour rester.
Le poids des représentations
L’ancienne internationale observe chez les jeunes joueuses une pression de devoir sans cesse prouver leur valeur: « Les filles sont souvent obligées d’être fortes pour être acceptées. C’est un peu dommage. Dans des milieux masculins, il faudra de toute façon un petit peu plus prouver qu’on a sa place et puis qu’on a le droit d’être là. », regrette-elle. « J’espère que les mentalités vont évoluer et que, quand deux équipes entrent sur le terrain et que l’une est composée de filles, il n’y ait plus de préjugés. »
Des rêves, mais les pieds sur terre
« Il faut toujours assurer ses arrières », conseille Sandy Maendly aux jeunes qui jonglent entre études et entraînements. Le football féminin ne garantit pas, même au haut niveau, une carrière financièrement stable. Elle insiste donc sur l’importance des études, tout en invitant les jeunes à se lancer pleinement, de foncer: « Toujours continuer, ne pas se poser trop de questions, sans pour autant perdre la réalité de vue. »
Par Oriane Le Meur, Robin Rufener, Lucie Ostorero
Ce travail journalistique a été réalisé pour le cours « Pratiques journalistiques thématiques » dans le cadre du master en journalisme de l’Académie du journalisme et des médias (AJM) de l’Université de Neuchâtel.Une version de cet article a été publiée dans 24 Heures, le 30 juin 2025