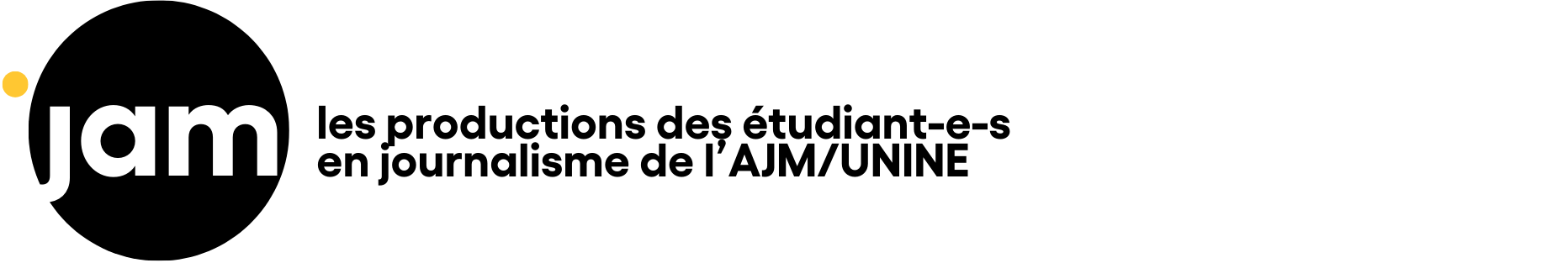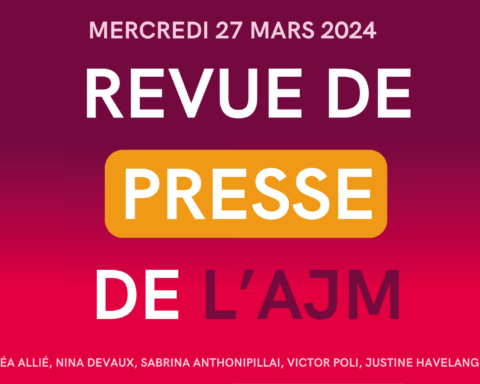Il faut ramener vos bouteilles en verre au magasin. C’est le crédo défendu par des réseaux de réemploi, récemment réapparus dans les cantons de Vaud et Genève. Depuis les années Covid, le secteur connaît une dynamique favorable et veut continuer à investir pour poursuivre son développement.
Une bouteille détourée sur fond vert, accompagnée de quelques francs. Ce sticker, peut-être collé sur vos contenants en verre, marque le retour de la consigne en Suisse romande. Ça Vaud’lretour dans le canton de Vaud, J’la ramène à Genève, Au Reverre au niveau national, les initiatives fleurissent pour détourner notre verre des containers.
Notre reportage radio :
Passer à une cadence industrielle
Collecter, frotter, rincer, sécher puis livrer. Depuis les pentes du Jura vaudois, l’atelier de Réseau Consignes nettoie les bocaux et bouteilles d’une douzaine de producteurs de la région (laiterie, jus de fruits, etc.). Hervé Le Pezennec, son fondateur, observe la dynamique du secteur avec enthousiasme: « Après cinq ans d’activité, on arrive à la limite de nos capacités, environ 100’000 lavages par année. Et la demande est toujours croissante. » Pour y répondre, il envisage d’investir dans une laveuse industrielle capable de faire briller 2’000 bouteilles par heure.
À Genève aussi, un investissement similaire est planifié par le réseau J’la ramène, initié par les services industriels du canton (SIG). Bien que les résultats actuels, à 16’000 lavages en 2024, soient en deçà des objectifs, il ambitionne de faire grimper ce chiffre à deux millions par année afin d’assurer sa pérennité financière. Son élargissement aux viticulteurs devrait bientôt lui permettre d’augmenter massivement le nombre de bouteilles récupérées.
Notre verre recyclé à l’étranger
Les réseaux romands rassemblent surtout des épiceries et des producteurs locaux, sans participation pour l’heure de la grande distribution. Pourtant, la fermeture de l’usine Vetropack l’an dernier devrait nous inciter à réemployer nos contenants, selon Hervé Le Pezennec: « La verrerie de St-Prex était la dernière de Suisse capable de recycler le verre et refondre des bouteilles. Désormais, 100% de notre verre part à l’étranger. Il y a donc un besoin de remettre en place des circuits de réutilisation. »
L’UE plus ambitieuse que la Suisse
Dans le même temps, l’Union européenne affiche des objectifs ambitieux. Elle a décidé de convertir 10% de son parc de contenants au réemploi d’ici à 2030. La France se montre encore plus volontariste et compte relever ce défi d’ici deux ans, bien qu’elle ne réemploie qu’un centième de son verre aujourd’hui. Des essais débuteront dans quatre régions du pays ce printemps, en intégrant les grands industriels de l’agro-alimentaire.
De son côté, la Suisse ne se fixe pas d’objectifs en la matière. Les acteurs du secteur espèrent que la dynamique européenne infusera par-delà les frontières, dans une Helvétie qui mise beaucoup sur le recyclage. En souhaitant que nos bouteilles cessent de se briser après quelques gorgées.
Notre reportage vidéo :
Des enjeux financiers mitigés
Bien que le retour de la consigne soit principalement motivé par des considérations écologiques – un lavage économise 79% d’énergie par rapport au recyclage – des enjeux financiers peuvent parfois inciter à opérer cette transition.
« Le coût d’un lavage se situe entre 20 et 35 centimes par bouteille, tandis que le prix d’achat atteint 30 à 60 centimes. Mais tout dépend beaucoup des modèles », relève Hervé Le Pezennec, fondateur de l’entreprise Réseau Consignes. Il note toutefois que les tarifs à l’achat peuvent notablement varier en fonction des quantités achetées et que le lavage est surtout rentable pour les grands contenants. « Une bouteille de bière neuve de 33 cl coûte entre 15 et 30 centimes en fonction du volume acheté, tandis que le lavage requiert 30 centimes. » Un constat qui se vérifie à la brasserie de La Pièce, pour qui le bilan financier plaide plutôt en défaveur du réemploi. Néanmoins, elle poursuit la démarche « par motivation purement écologique, parce que la consigne évite de produire des déchets », explique Laurent Serex, l’un des deux brasseurs.
En revanche, l’envol du prix du verre suite au déclenchement de la guerre en Ukraine aura participé à renforcer l’attractivité du réemploi. Les verreries ont répercuté la hausse des tarifs du gaz, brûlé pour faire rougir leurs fours jusqu’à 1500°C, provoquant un renchérissement de près de 50% sur leurs bouteilles (surtout celles en verre blanc). Les producteurs ont également dû composer avec les ruptures d’approvisionnements, certains modèles se révélant introuvables au moment de transformer leur récolte. « Cette situation catastrophique place le projet du réemploi sous une bonne lumière : en utilisant des bouteilles collectées et lavées localement, on atteint une forme de résilience et une meilleure maitrise des coûts », relève Jean-Marc Zgraggen, chef du projet J’la ramène aux SIG.
Une logistique à adapter
Mais réutiliser ses bouteilles nécessite aussi d’adapter sa logistique. Les producteurs doivent prévoir de l’espace pour stocker leurs contenants en attente de lavage. Ceux de la brasserie de La Pièce patientent dans une grange voisine, mais Laurent Serex note que cette problématique « peut être un frein pour les entreprises qui utiliseraient des contenants en verre, parce qu’en général, cet espace de stockage représente du loyer ».
Simplifier la logistique apparait comme une piste prometteuse pour réduire le coût du réemploi. Une bouteille unique est par ailleurs en cours de développement par un collectif de viticulteurs, scrutée avec intérêt par les acteurs du secteur. Vue comme une manière de faciliter la manutention et le triage des contenants, les consommateurs peuvent eux déjà retourner leurs bouteilles affublées du fameux sticker chez n’importe quel commerce partenaire.