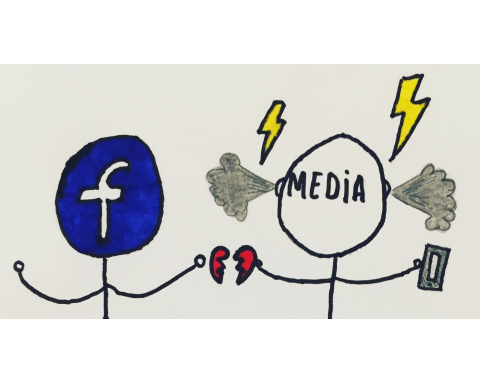Les cadres juridiques influencent le traitement de l’information. C’est la leçon à tirer d’une conférence donnée par Fulvio Sarzana, blogueur et avocat spécialiste des médias, et Fabio Bertoni, conseiller juridique au New Yorker. Cette influence s’exerce notamment dans la couverture du hashtag MeToo par les médias, et plus généralement des faits relevant de harcèlements et d’abus sexuels.

Le poids des réseaux sociaux
Souvenez-vous, en octobre 2017, Alyssa Milano déclenchait la vague #MeToo suite aux publications du New Yorker et du New York Times sur le comportement de Harvey Weinstein par son tweet :
If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n
— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15 octobre 2017
L’avalanche de réactions suscitée par le hashtag MeToo, plus d’un demi-million de tweets en quelques jours, a aussi permis à la presse, prise en étau par le droit, d’informer plus librement d’un sujet qui ne sortait que rarement des rédactions.
Le risque de la diffamation
« Le premier obstacle est qu’il n’y a généralement que deux personnes impliquées » déclare Fabio Bertoni, « il faut souvent attendre que ces personnes en parlent à d’autres avant d’imaginer écrire quoi que ce soit, c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre ». C’est que la diffamation par voie de presse peut être sévèrement punie, comme le souligne la Commission de Venise dans son avis de 2013 (voir ci-dessous). L’Italie est en porte-à-faux avec la Cour européenne des droits de l’homme sur ce point. Au pays de Dante elle relève d’une infraction pénale et peut être sanctionnée d’une peine de prison allant de six mois à six ans de prison.
Avis sur la législation italienne relative à la diffamation
Diffamation : avis sur la législation italienne
« En 2011 et 2012, trois journalistes et trois directeurs de presse ont été condamnés à des peines de prison pour diffamation » relève l’avis de la Commission de Venise. « C’est une aberration ! » s’exclame Fulvio Sarzana. Une peine de prison, même avec sursis, a un effet dissuasif disproportionné selon la commission. « Les Etats-Unis donnent plus de marge de manœuvre dans ce domaine, et vous ne verrez pas la diffamation rentrer dans le code pénal » conclut-il.
Contrats de confidentialité
La dissuasion s’exerce différemment selon les cadres juridiques. Si des rédactions subissent directement des pressions, celles-ci passent parfois via le bâillonnement des victimes, lorsqu’elles signent des « no-disclosure agreement » notamment aux Etats-Unis. Ces contrats de non-divulgation se négocient entre personnes impliquées et peuvent se conclure par un dédommagement financier important. Contrairement à une procédure devant le tribunal, ceux-ci sont confidentiels en tous points. « Les contrats sont au cœur du système juridique » souligne Fabio Bertoni, « ils sont par conséquent fortement protégés ». En cas de divulgation, les sanctions économiques peuvent être énormes et incitent de ce fait à ne rien dire. Dans ses conditions, la presse porterait préjudice à la victime en publiant des informations dont elle aurait possession.
C’est ce type de contrat qui est en cause dans l’affaire de Trump et de ses anciennes maitresses présumées. Comme le révélait Le Figaro fin mars, Michael Cohen, avocat du président, exigerait 20 millions de dollars en cas de rupture du contrat de non-divulgation qui le lie à Stormy Daniels, l’actrice porno qui soutient avoir eu une relation secrète avec Trump entre 2006 et 2007.
Crédit photo d’illustration : Tom Joseph