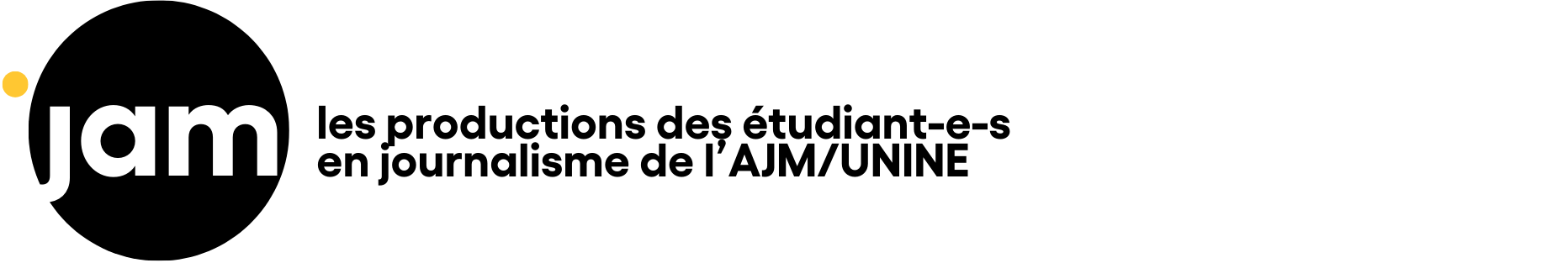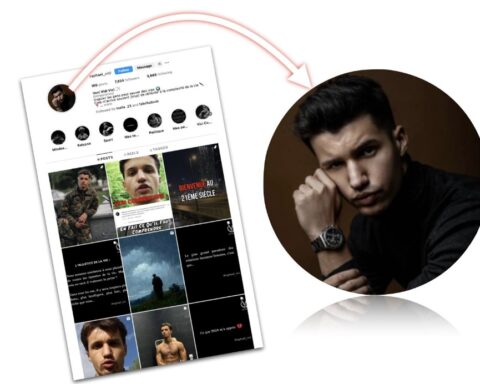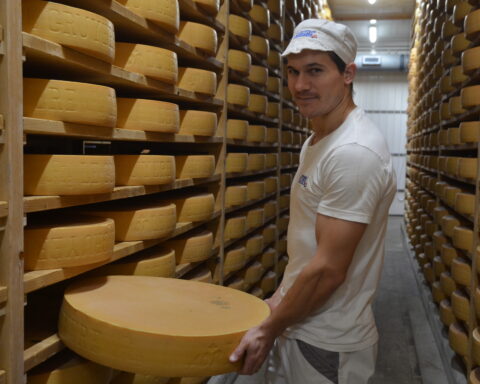Des maisonnées antiques aux familles recomposées, le concept de la famille change. Patriarcale, éclatée ou recomposée : ce socle souvent présenté comme immuable n’a cessé d’évoluer au fil des siècles.
À lire aussi
Cet article fait partie d’un dossier consacré à la famille traditionnelle en Suisse: exploration de son évolution, des débats qu’elle suscite et des tensions qu’elle cristallise encore aujourd’hui. L’ensemble des articles est à retrouver ci-dessous.
- Entre fidélité aux racines chrétiennes et adaptation aux réalités sociales, les partis bourgeois suisses peinent à s’accorder sur la notion de famille: L’évolution de la famille met les partis bourgeois suisses sous tension
- La Suisse est l’un des derniers pays européens à interdire la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires. Thalia* raconte la maternité sans partenaire. Devenir maman solo, «au moins, avec la PMA, c’est un vrai choix»
- Défenseur d’un ordre masculin assumé, Raphaël Vici milite pour un retour aux fondamentaux familiaux et virils: «Les hommes et femmes ne sont pas égaux mais complémentaires»
- Un élu du parti socialiste incarne les tensions entre foi, engagement politique à gauche et attachement au modèle familial traditionnel: Quelle place pour la famille tradi au PS?
Issu du latin familia, le mot «famille» fait apparaître des représentations précises dans les esprits de chacun-e. Toutefois, sa signification mue avec le temps. L’héritage de père en fils ou trois générations –grands-parents, parents et enfants– sous un même toit, sont des idées pas aussi rigides que les piliers d’un temple grec. Comme tout concept historique, le retracer précisément relève d’un travail de Sisyphe, même s’il est possible d’esquisser quelques grands traits de son évolution.
L’Empire romain comme point de départ
Il y a deux mille ans, à l’époque romaine, la famille désigne un ensemble économique. On parle «plutôt de la maisonnée comprenant tous les gens qui habitaient dans l’entourage d’un citoyen romain», explique Thalia Brero, professeure d’histoire médiévale de l’université de Neuchâtel.
Il ne s’agissait donc pas uniquement d’un groupe de parents, mais d’un ensemble élargi, souvent au service de l’autorité patriarcale. La famille regroupait alors tous les membres travaillant pour le maître de la maison.
Un peu plus tard, au Moyen Âge, le concept connaît «des alternances entre des logiques d’héritage verticales, à savoir du père au fils comme à l’époque romaine, et horizontales, avec une répartition entre enfants comme à l’époque germanique lorsque les peuples du Nord migrent en Europe centrale», continue d’expliquer Thalia Brero.
Depuis l’extinction de l’Empire romain en Occident (476 de notre ère) jusqu’à l’an mille environ, l’influence germanique horizontale remplace l’héritage romain vertical. Tous les enfants héritent, «les femmes y compris. Elles pouvaient carrément régner», ajoute l’experte.
Avec ou sans nom de famille
«Les familles sont alors plus ouvertes », estime l’historienne. Les enfants naissaient en ou hors mariage. «Les bâtards et même la polygamie étaient des choses courantes au haut Moyen Âge», affirme Thalia Brero.
Durant cette période, les noms de famille disparaissaient. «Les parents s’appellent Radegonde et Chilpéric et le nom des enfants résulte d’un mélange des prénoms. Ce sont Chilpéronde et Radéric, s’amuse Thalia Brero. C’est un peu comme les Kardashian’s, aujourd’hui, avec tous leurs prénoms en K.»
Cependant, la montée en puissance de l’Église réintroduit un modèle strictement vertical à partir de l’an mille, renforçant la transmission patrimoniale. Le fils aîné est mis en avant pour l’héritage et le mariage réservé aux seules élites: «Tout le monde ne pouvait pas se marier, il fallait être à l’aise financièrement, et les enfants hors mariage n’étaient plus tolérés», explique l’experte. Ce modèle perdurera jusqu’à l’émergence du mariage d’amour aux alentours du XIXe siècle.
L’apparition de la famille traditionnelle au XXe siècle
À peine avant, au XIXe siècle, naît «le modèle bourgeois de la famille, une famille dans laquelle l’homme travaille et la femme s’occupe des enfants», décrit Jean-Marie Le Goff, sociologue et démographe. Ce modèle idéalisé, que l’expert de l’Université de Lausanne qualifie aussi de «modèle romantique ou traditionnel», connaît son apogée dans les années 1950-60.
Anne-Françoise Praz, historienne contemporaine de l’Université de Fribourg, précise: «La famille nucléaire, comprenant parents et enfants, est idéalisée. Celui qui n’avait pas de famille n’avait pas de possibilité de survie.»
Ce modèle va progressivement se modifier. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les femmes accèdent au marché du travail et au droit de vote. «C’est le début de l’essor de l’emploi à temps partiel», note Jean-Marie Le Goff.
À partir des années 1990, ce sont les mères qui négocient ce type d’emplois dès la naissance du premier enfant. «Cela crée une inégalité structurelle», souligne-t-il, notamment dans les retraites, où «les femmes ne cotisent pas un deuxième pilier et leurs pensions sont plus faibles.»
La diversification des modèles
Parallèlement, les formes familiales se diversifient: familles monoparentales, homoparentales, recomposées. Anne-Françoise Praz rappelle que «jusqu’aux années 1960, avoir un enfant hors mariage était un drame»; aujourd’hui, les représentations ont changé grâce à l’évolution sociale, à la contraception et aux médias qui donnent de la visibilité aux inégalités.
Une situation mise sous tension de nos jours. «Les jeunes d’aujourd’hui semblent parfois plus traditionnels», observe Jean-Marie Le Goff, mais il interroge: «Est-ce une nostalgie ou un effet de génération n’ayant pas encore expérimenté la parentalité ?»
La famille, un synonyme de métamorphose. Une évolution qui continue d’influencer la conception de la famille encore aujourd’hui. Thalia Brero termine : «L’histoire ne va pas dans un sens. Il y a des évolutions qui apparaissent et qui reviennent.»