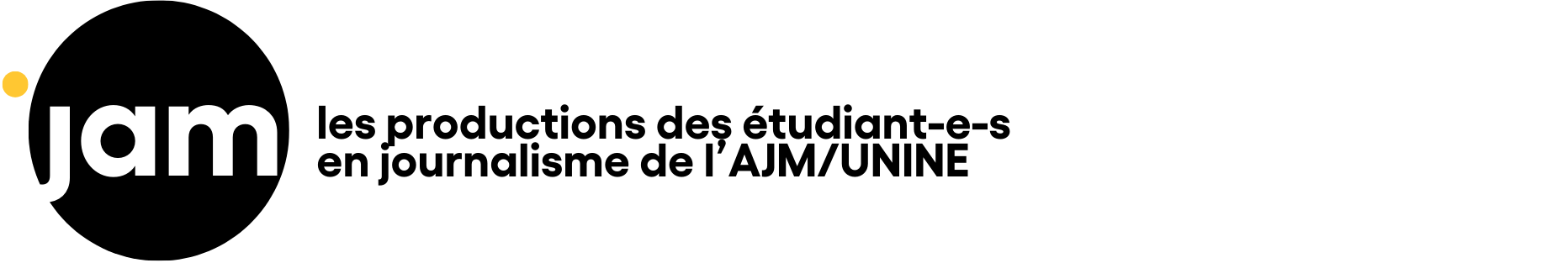Ils sont environ 115 au départ et il n’en restera que 26. À Neuchâtel, seuls 30% des étudiants en médecine accèdent à la deuxième année. Un concours stressant qui peut entrainer des conséquences négatives sur la santé des étudiants.
Réputées difficiles, les études de médecine attirent pourtant chaque année des centaines d’étudiants. À la faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel, seuls 26 candidats sont sélectionnés pour poursuivre leurs études. À l’heure où une pénurie de médecins généralistes commence à se faire sentir en Suisse, ce chiffre semble dérisoire. Dans le cadre de cet article, nous avons réalisé un sondage auprès des étudiants en première année en médecine. Si les résultats donnent une bonne indication de leur ressenti, ils ne sont pas représentatifs, car seules 39 personnes sur les 96 étudiants de leur groupe Whatsapp ont répondu.
Une rivalité contre-productive
La limitation des places pour la deuxième année tend à créer une forte rivalité entre les étudiants. Gregory Röder, professeur titulaire et responsable des études de médecine humaine à l’Université de Neuchâtel, explique que la formation est « exigeante, passionnante mais aussi très sélective ». Un cursus qui, selon le professeur, permet aux futurs médecins de répondre aux standards de qualité du système de santé suisse. Un avis que ne partage pas Léa*, qui a préféré arrêter ses études de médecine après le premier semestre. Elle confie: « Je n’étais pas prête à rentrer dans ce système de compétition où il faut essayer d’être la meilleure et où les autres nous écrasent pour réussir. » Si certains étudiants considèrent cette rivalité comme source de motivation, la plupart d’entre eux la qualifient de destructrice (43,6% des répondants).
Je n’étais pas prête à rentrer dans ce système de compétition où il faut essayer d’être la meilleure et où les autres nous écrasent pour réussir.
Léa*, ancienne étudiante en médecine
À Neuchâtel, 20% des répondants affirment avoir déjà été déstabilisés par des camarades. Des actes parfois insidieux et une situation trop compétitive que Jade, qui a aussi récemment renoncé à la médecine, explique: « Une personne avec qui je m’entendais bien essayait souvent de me déstabiliser en comparant ses heures de travail aux miennes et en me conseillant de tout arrêter si je n’obtenais pas la moyenne au premier semestre. » La Jurassienne a tenté la sélection à deux reprises, elle décrit une ambiance relativement bonne, bien que très anxiogène: « J’ai commencé à faire des crises d’angoisse, alors que je pensais que tout allait bien. » Tous les étudiants ne se retrouvent pas dans pareille situation, mais le stress permanent provoqué par l’envie d’être le meilleur génère des effets généralement négatifs sur la santé mentale et physique.
La moyenne ne suffit pas
Travailleur social et thérapeute de couple et de famille au Cerfasy (Centre de recherche familiale et systémique), Michel Cattin rencontre occasionnellement des étudiants de la faculté de médecine de l’Université de Neuchâtel. Il explique qu’être accepté en fonction d’un nombre défini et non uniquement sur la base des résultats induit une inégalité « dommageable pour la santé psychique ». Après ses examens, l’étudiant qui obtient la moyenne valide son année et ses crédits. Cependant, si sa moyenne est inférieure à celle du 26e candidat classé, il sera refusé. À ce sujet, Michel Cattin ajoute: « Ce type de concours est très frustrant, car l’étudiant est spectateur de son échec. »
Sur les 39 personnes interrogées, 33 évaluent leur niveau de stress entre 7 et 10 sur 10. Afin d’aider les étudiants, l’Université offre trois séances de psychothérapie avec le Cerfasy. Mais selon le thérapeute, « ces séances ne sont pas une bonne chose, car elles sont proposées par l’Université. On les malmène d’un côté pour les aider de l’autre, ça ne fait aucun sens ». Toujours selon Michel Cattin, si les étudiants souhaitent faire changer les choses, ils auraient avantage à s’adresser aux associations étudiantes, mieux placées pour défendre leur parole.
On malmène les étudiants d’un côté pour les aider de l’autre, ça ne fait aucun sens.
Michel Cattin, travailleur social et thérapeute de couple et famille, Cerfasy
Un secteur sous pression
Les universités suisses connaissent des évolutions continues. Gregory Röder explique que l’Université de Neuchâtel est passée d’une sélection de 21 à 26 candidats en fin de la première année (+24%). Des changements importants, mais qu’il estime insuffisants. Malgré ses quelque 1200 médecins formés annuellement et l’apport de médecins étrangers (40% du total), la Suisse reste dans une situation délicate. Entre le changement démographique, le départ à la retraite de nombreux médecins et l’abandon de 34% des étudiants après leur premier stage en hôpital, la profession fait face à un avenir plus qu’incertain.
Pour Gregory Röder, si les universités ont la volonté de former plus de médecins, elles sont toutefois dépendantes de facteurs extérieurs qui les contraignent à limiter les places. Le premier élément repose sur le coût de formation d’un médecin, estimé à 720’000 francs pour six années de formation. Cela correspond principalement à la formation et à la recherche au sein de l’université. S’ajoute à cela la volonté de diminuer les coûts de la santé en réduisant les séjours stationnaires (avec nuit en hôpital), ce qui pose également problème pour la formation. Effectivement, les étudiants de 3e, 4e et 6e année doivent réaliser des stages et apprentissages en hôpital, mais le nombre de cas médicaux dans les hôpitaux universitaires est insuffisant pour le nombre d’étudiants à former. Pour remédier à cette situation, les étudiants sont ainsi dirigés vers les hôpitaux périphériques. Ces infrastructures ont pour mission première de soigner et non de former, ce qui induit des besoins en compétences, en temps et en matériel qu’elles n’ont pas forcément.
Récemment, plusieurs émissions de la RTS ont mis en lumière le quotidien difficile de certains médecins. Si la plupart des étudiants se disent motivés à poursuivre, il est évident que leur chemin comportera encore de nombreux défis. Ce système en pousse certains à choisir la Roumanie pour se former à la médecine, mais beaucoup sont contraints de renoncer à leurs rêves, à l’image de Léa* et Jade. Cette dernière explique: « Médecine, c’était mon rêve, mais je pense qu’il faudrait revoir tout le système. »
Des études possibles en Roumanie
Les étudiants qui subissent un double échec en médecine à Neuchâtel sont dans l’impossibilité d’étudier la médecine en Suisse pour une durée de 5 ans. Cette interdiction est de 7 ans pour l’Université de Lausanne et à vie pour celle de Genève. Un principe qui incite les étudiants les plus motivés à recommencer leurs études en Roumanie. Le pays propose une formation en médecine reconnue en Suisse et davantage orientée sur la pratique. Si les étudiants souhaitent revenir en territoire helvétique après leurs études, ils devront tout de même se réimmatriculer pour passer le diplôme fédéral et pouvoir ainsi exercer dans le pays. En 2024, plus d’une centaine de Suisses étaient inscrits dans la faculté de médecine de l’Université Cluj-Napoca.
* Léa a préféré l’anonymat car elle poursuit ses études au sein de l’UniNE.