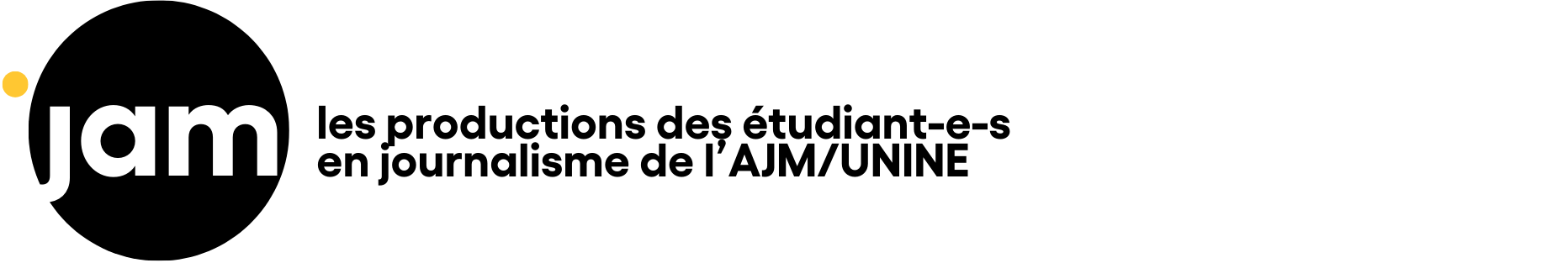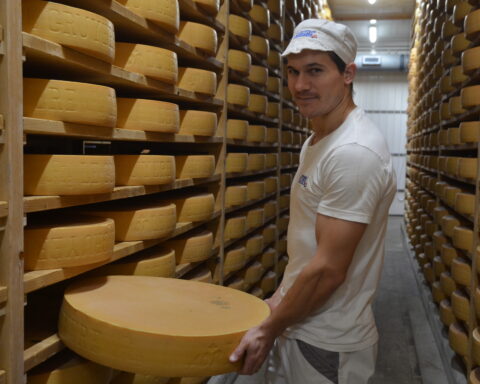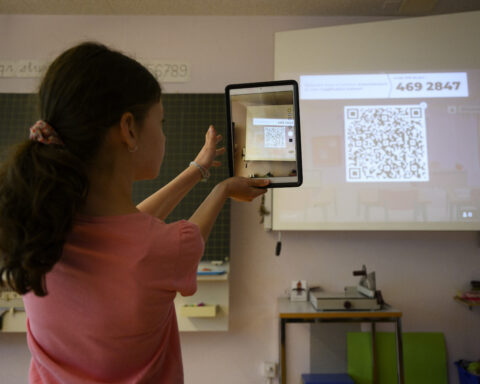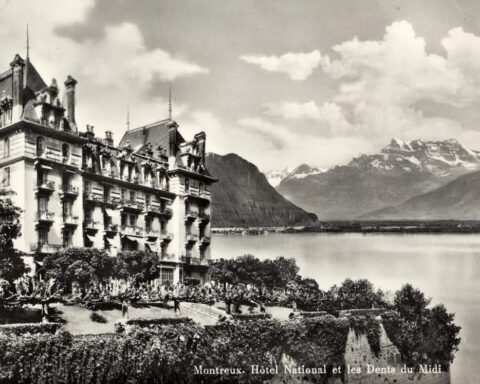En Suisse, l’agriculture biologique gagne du terrain dans nos exploitations comme dans nos assiettes. Cette tendance, associée à la volonté de limiter l’usage et la consommation de pesticides, s’explique par les préoccupations environnementales ainsi que par la situation économique des ménages. Tour d’horizon agricole en Suisse et chez nos voisins français pour analyser cette montée en puissance.
La progression de la production biologique illustre une évolution marquante dans la viticulture et l’agriculture en général. Celle-ci témoigne ainsi de l’importance stratégique revêtue par le bio en réponse aux besoins liés à la durabilité. L’agriculture dite conventionnelle, au contraire, est moins regardante face à cette problématique en laissant droit à l’utilisation de plusieurs types de pesticides. Ces réglementations au niveau de l’agriculture bio ou conventionnelle varient donc d’un pays ou d’un label à l’autre et sont difficilement comparables.
Concernant l’agriculture bio, en Suisse, elle repose sur des principes stricts définis par des labels tels que Bio Suisse ou Demeter. Ces critères incluent, entre autres, l’interdiction des pesticides et engrais chimiques de synthèse, la promotion de la biodiversité, le bien-être animal et la rotation des cultures. Le respect des sols, de l’eau et des ressources naturelles est central. Ces pratiques visent à répondre aux préoccupations écologiques tout en garantissant des produits de haute qualité, tant sur le plan gustatif que nutritif. Cette approche vise à renforcer la confiance des consommateurs et a pour objectif de soutenir les méthodes d’agriculture durable.
En France, l’agriculture biologique repose également sur un socle d’activité agricole prônant de meilleures pratiques environnementales. À l’instar des labels bio suisses, elle exclut l’usage d’OGM et restreint fortement l’utilisation de pesticides. En outre, la production bio française est encadrée par une réglementation européenne dont les produits sont reconnaissables grâce au logo Eurofeuille ou la marque AB, propriété du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Boom des fermes biologiques
En Suisse comme en France, le nombre d’exploitations agricoles biologiques connaît une forte croissance. Parmi les 47’719 exploitations helvétiques recensées, 7’896 sont désormais en bio. Depuis 2010, ce chiffre ne cesse d’augmenter, passant de 5’659 à 7’896 fermes en 2023: ce qui représente une augmentation de 39,5% sur plus d’une décennie. Aujourd’hui, au niveau des hectares, la production bio couvre un cinquième de la surface agricole utile. Outre les fermes agricoles, les domaines biologiques incluent également les vignobles qui représentent, selon le dernier rapport annuel de BIO Suisse, une part d’environ 19,9% de l’agriculture bio totale.
Certains cantons se démarquent particulièrement. En 2023, Berne reste en tête avec 1’445 fermes bio (+0,2%), suivi de près par les Grisons qui comptent 1’261 exploitations (-1,1%). Toutefois, ces cantons enregistrent une stagnation, voire une diminution, dans la progression des parts agricoles bio par rapport à l’année précédente. À l’inverse, les cantons de Genève et Schaffhouse affichent une nette progression chiffrée à 17,3% pour le premier et 23,8% pour le second.
La tendance au bio s’observe également en France, bien que le nombre d’exploitations agricoles y soit en baisse. En 2020, on dénombrait environ 390’000 fermes, marquant une diminution annuelle moyenne de 2,3% entre 2010 et 2020. Malgré cette diminution constante, la part dédiée à l’agriculture biologique ne cesse de croître. Alors qu’on comptait 53’255 exploitations biologiques en 2020, ce chiffre est passé à 60’483 en 2022, enregistrant ainsi une hausse de 13,6%. Par ailleurs, la superficie agricole moyenne utilisée par exploitation, tout type de production confondu, est en hausse: elle est passée de 55 ha en 2010 à 69 ha en 2020. En 2023, la surface dédiée à l’agriculture biologique représente ainsi environ 10% de la surface agricole totale.
Il est intéressant toutefois de nuancer ces chiffres, car il s’agit d’exploitations engagées dans l’agriculture biologique. Alors que les exploitations biologiques suisses doivent obligatoirement produire l’entièreté de leurs denrées sous le label bio, les fermes françaises ont la possibilité de pratiquer une agriculture sectorielle. Ainsi, certains produits d’une même exploitation peuvent être certifiés bio, tandis que d’autres proviennent de l’agriculture conventionnelle. Par exemple, il est possible en France de cultiver du blé en bio tout en produisant des pommes de terre ou en élevant des volailles de manière conventionnelle. En Suisse, en revanche, l’ensemble de l’exploitation doit répondre aux normes bio si l’agriculteur souhaite obtenir le label.
Gros mangeurs de bio?
La montée en puissance du bio dépasse donc largement nos frontières, s'étendant également chez nos voisins européens. Plus qu'une simple tendance nationale, il s'agit d'un phénomène en pleine expansion dans les sociétés occidentales. Pourtant, lorsqu’il s’agit de ses assiettes, la Suisse s'affirme comme leader européen de la consommation de produits bio, avec une dépense moyenne record de 454 francs par habitant en 2023. Le chiffre d'affaires total atteint en moyenne 4,075 milliards de francs. Il est en hausse de 6,9% par rapport à l'année précédente.
Le secteur inhérent à la production biologique continue de grandir et séduit chaque année davantage de consommateurs suisses. En 2023, 44% de la population affirme consommer souvent ou systématiquement des produits bio; une tendance que l’on observe parallèlement à la part des dépenses des ménages pour les produits alimentaires bio, ayant triplé entre les années 2000 et 2021.
Cependant, certains enjeux majeurs subsistent tels que la justification pécuniaire des produits issus d’une production biologique. En effet, malgré une augmentation des exploitations biologiques françaises, nos voisins tendent à se détourner de ces aliments. Si l’on continue d’observer une augmentation stable de l’achat et la consommation de denrées bio, celle-ci ralentit à partir de 2018. En 2020, le chiffre d'affaires annuel des produits alimentaires biologiques dans la grande distribution n'a progressé que de 12%, contre 23% en 2018.
Le recul des achats bio s’explique par la différence de prix entre les produits issus de l’agriculture conventionnelle et ceux issus de l’agriculture biologique. Par exemple, en 2020, l’écart de prix entre un kilo de farine bio et un kilo de farine conventionnel s’élève à 1,10 euro en France métropolitaine. Cette situation met en évidence l'impact du contexte inflationniste sur les habitudes de consommation des Français.
Une durabilité à nuancer…
Bertrand Gigaud, agriculteur à Donatyre (VD), d’un domaine de plus de 70 ha questionne la pertinence des labels bio: "Si le bio était plus rentable et que j'avais un domaine plus petit, je me serais lancé. Mais actuellement, cela ne serait pas financièrement viable. Le bio suisse est très strict et ne permet pas de le pratiquer de manière sectorielle. Ta ferme doit être entièrement bio ou ne pas l’être du tout, contrairement à la France."
Pour l’agriculteur, l'un des problèmes majeurs de l’agriculture biologique certifiée réside dans les conséquences sociales souvent associées à ce mode de production. En effet, produire bio demande davantage de main-d’œuvre, ce qui peut entraîner le risque d’une rémunération insuffisante pour les travailleurs. D’après lui, les labels bio français se rapprocheraient des normes de l’agriculture conventionnelle suisse: "Je travaille avec le label IP-Suisse qui se situe, selon moi, entre le bio et le conventionnel. Il impose des règles qui sont durables, mais qui permettent de faire fonctionner mon domaine au niveau financier." Bertrand Gigaud souligne ainsi qu’il est essentiel de se rappeler que derrière des labels comme Bio Suisse, il y a avant tout une marque dont l’aspect commercial ne doit pas être négligé.
Au final, malgré une tendance globale à la production biologique et donc à une moindre utilisation de pesticides, le bio soulève certaines problématiques. La principale, qui fait consensus tant chez les consommateurs que chez les producteurs, est la suivante: le bio coûte trop cher.
Par Manon Savary & Tatiana Silva de Sousa
Ce travail journalistique a été réalisé pour le cours « Publication, édition et valorisation numérique », dans le cadre du master en journalisme de l’Académie du journalisme et des médias (AJM) de l’Université de Neuchâtel.