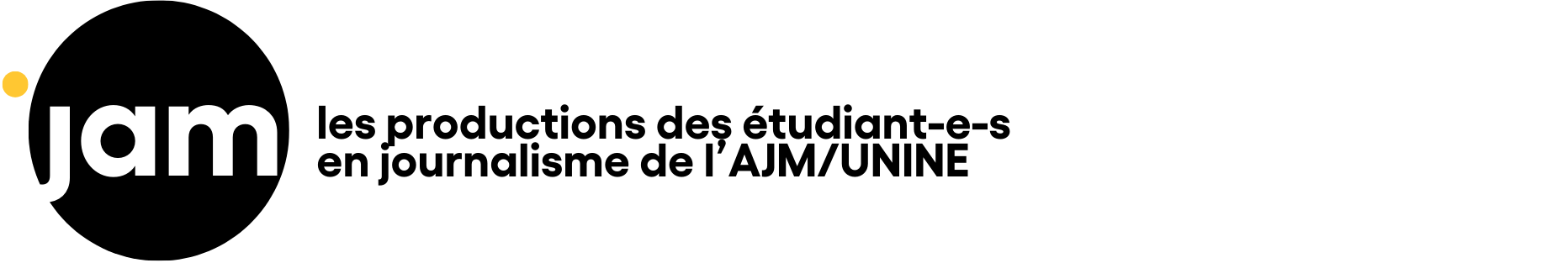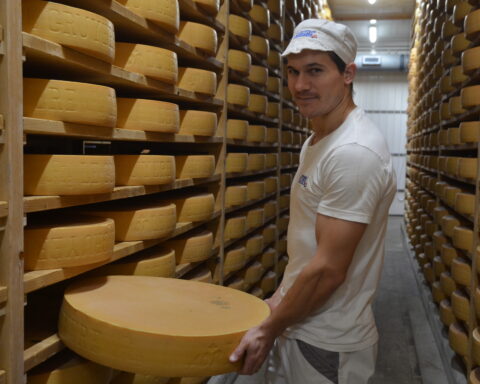Chef circulation des trains est un métier exigeant, actif de jour comme de nuit. Reportage sur un des rôles clés des CFF, où humain et machine sont complémentaires.
De la musique jazz, un bip de temps à autre, la nuit est calme à Saint-Triphon. Pas de travaux sur les voies ce samedi soir, seulement des trains. Soudain, le téléphone sonne; c’est le régulateur du trafic pour la région Rhône.
«Chef circulation Saint-Triphon je t’écoute», répond Hakim Sahal, en service ce soir-là. Un train italien a perdu trois minutes dans le secteur du Chablais, celui d’Hakim, et son collègue spécialiste de la planification des opérations vient aux nouvelles.
«Le mécanicien t’a dit quelque chose?» demande la voix au bout du fil. Aussi appelés pilotes de locomotive, ils doivent communiquer les anomalies rencontrées à la personne responsable du secteur. Mais Hakim n’a reçu aucun appel. Pas une alarme sur les écrans, juste un ralentissement inexpliqué.
«Face à un signal cassé ou un animal au bord des voies, les pilotes ne savent pas si d’autres nous ont déjà prévenus. Il faut parfois attendre le passage de plusieurs trains pour recevoir un premier appel.»
Hakim Sahal, chef circulation des trains (CFF)
En constante évolution
«Le trafic ferroviaire romand est désormais piloté depuis Renens» annonçaient les CFF le 1er septembre 2024. Tout le trafic romand? Non. «Les chefs circulation des trains sont en surface durant leur première année de carrière», explique Hakim — lui-même concerné. L’expression «en surface» fait référence au terme «gare de surface», c’est-à-dire les gares comme St-Triphon, non-pilotées à distance.
À l’image de la gare de Roche en travaux ce mois de novembre, les CFF sont en constante évolution. Depuis leur création en 1902, la technologie n’a cessé d’évoluer. L’automatisation et le contrôle à distance apportés par l’informatique permettent de centraliser une bonne partie des opérations, mais mettre 3’264 kilomètres de réseau à la page se fait par étapes.

La gare de St-Triphon est le parfait exemple de cette évolution progressive. Ouverte aux voyageurs à l’origine, son bâtiment principal accueillait des guichets et le contrôle du trafic régulier. Concernant les manœuvres, elles étaient pilotées depuis une cabine au bord des voies correspondantes.
Plus tard, télécommander les opérations à distance est devenu possible. Le tableau de contrôle des manœuvres a alors déménagé dans le bureau principal — une personne cumulant désormais les deux tâches. Les guichets ont disparu avec les voyageurs en 1991, libérant de l’espace pour les casiers des chefs circulation. «Notre bureau s’est vidé en même temps qu’il grandissait», plaisante Hakim en faisant le tour du propriétaire.
St-Triphon s’est ensuite imposé comme l’unique centre de contrôle du Chablais, regroupant les gares de Roche, Aigle, St-Triphon et Bex. Le processus de centralisation se poursuit de nos jours et Renens devrait prendre le contrôle des opérations du Chablais à l’horizon 2026. Quitter la solitude d’une gare fantôme pour l’animation des bureaux renanais, Hakim s’en réjouit.
Le facteur humain
La profession a bien changé depuis les années 1970. Les ordinateurs ont permis l’automatisation de beaucoup de tâches, mais le rôle de l’humain reste prépondérant aux CFF. La journée est rythmée par les sonneries de téléphone, la résolution de problèmes — souvent des dilemmes — et les manœuvres à coordonner.
«Quand je suis en service, les voies sont sous ma responsabilité. On communique beaucoup avec les mécaniciens et les régulateurs. Ils peuvent me donner leur avis, mais à la fin, c’est à moi de décider.»
Hakim Sahal, chef circulation des trains (CFF)
«Aujourd’hui, l’informatique permet de combiner plusieurs actions en un seul clic et de faire une bonne partie des vérifications de sécurité», explique Hakim. En revanche, prendre les décisions restent l’apanage de l’humain derrière le clavier. Il se passe toujours plein de choses dans le monde ferroviaire, y compris la nuit. Les travaux en sont un parfait exemple.

«Lorsqu’une voie est en travaux ou bloquée par quelque chose, elle devient interdite», explique Hakim. Il pointe la voie 2 de la gare de Roche du doigt —en rouge sur son écran— et ajoute, «qui dit voie interdite, dit adaptation des itinéraires et parfois des horaires. Les régulateurs et chefs circulation ajustent le trafic en conséquence, travaillent ensemble pour que tout se passe au mieux.»
Un travail solitaire
Sept jours sur sept, 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu’un derrière les écrans. Alternant les shifts de neuf heures entre le matin, l’après-midi et la nuit suivant les semaines, les chefs circulation ont un rythme de vie décalé. Parfois en service durant le weekend, leurs congés tombent souvent lorsque les autres travaillent. Voir ses amis ou sa famille est très compliqué.
La centralisation et l’informatisation ont aussi leurs revers, surtout pour les personnes en surface comme Hakim. «Dans mon travail, on parle à plein de gens par téléphone sans jamais croiser personne, plaisante-t-il. Travailler seul ne me dérange pas, mais j’ai tout de même hâte de rejoindre Renens pour côtoyer mes collègues davantage.»
«Il faut avoir une bonne hygiène de vie pour faire ce travail», enchaîne-t-il en sortant des cartes plastifiées d’un tiroir. Sur ces fiches, des images et quelques conseils importants sur des sujets comme l’alimentation, le sport et le sommeil. Tous ces thèmes sont abordés en détail durant la formation. «C’est un métier exigeant sur le plan mental et les CFF en sont conscients», explique Hakim.
Comme beaucoup dans son domaine d’activité, il travaille à 100%. Selon lui, un poste à temps partiel serait une solution possible à son rythme de vie décalé, source d’un véritable «déphasage social», selon Hakim. Les CFF mettent d’ailleurs l’accent sur cette forme de travail depuis quelques années, notamment chez les femmes. L’entreprise, en léger sous-effectif, ne peut pas encore généraliser la pratique. Toutefois, à l’heure où certaines industries licencient en masse, le ferroviaire suisse, lui, recrute.