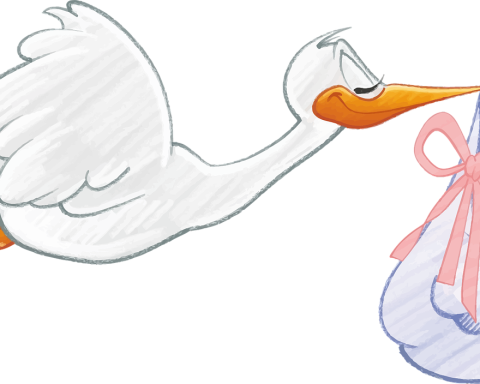Une exception qui confirme la règle: ce n’est ni une femme, ni un enfant, et il ne souhaite pas retourner en Ukraine. Habitant en Suisse depuis la mi-avril 2022, Egor compte rester ici. Rencontre.
Mercredi, peu après 16 heures. La porte s’ouvre au dernier étage de cet immeuble du centre-ville neuchâtelois. Dans l’entrebâillement, une silhouette imposante se distingue. «Hello.» Le jeune homme ne pourrait le nier, sa carrure suggère la maîtrise d’un sport de combat. Son regard, rassurant de timidité, révèle pourtant une personnalité en contraste avec ce gabarit: Egor est quelqu’un de plutôt réservé.
Depuis quelques mois, Egor détient une petite carte, violette et plastifiée. Cette carte, ils sont près de 70 000 Ukrainiens à l’avoir obtenue. C’est un statut de protection S, qui octroie au jeune homme le droit de séjourner en Suisse jusqu’en mars 2024. Un droit qu’il ne perçoit pas comme la plupart des autres réfugiés: «Tous ceux que j’ai croisés veulent rentrer. Pour moi, le permis S n’est que la première étape. J’aimerais pouvoir à terme obtenir le passeport.»
Un besoin de partir dès le plus jeune âge
Enfant unique de parents séparés, Egor vient de Yalta, en Crimée. Et si la mère a déménagé à Kiev après un divorce quand il était petit, le fils est resté vivre dans le domicile familial. Même après l’annexion russe de la région en 2014, car son père adhère à la politique du gouvernement russe. Depuis, leur relation est difficile. «Avec l’occupation, c’est devenu un peu comme en URSS. Avoir une opinion divergente est dangereux.» La pudeur d’Egor le pousse à esquisser un sourire nerveux quand il dévoile son enfance. Cette expérience de vie a forgé un garçon attiré par le monde extérieur. «J’ai toujours voulu essayer de nouvelles choses. C’est dans ma nature.» Mais il y a huit ans, l’adolescent était encore trop jeune pour partir. Toute ambition de départ n’était que simple rêverie.
Le 24 février 2022 marque un tournant pour Egor. L’invasion russe dans le reste du pays accentue cette sensation d’être «enfermé dans une prison». C’est le moment de partir. 25 ans: il a maintenant l’âge pour le faire, et après un mois et demi de travail alimentaire, l’argent aussi. Pendant ce temps, il a pu choisir avec minutie sa destination. Bien que l’anglais ne soit pas une langue nationale, la neutralité et la richesse suisses l’ont finalement convaincu. «C’est un pays dans lequel j’arrive à imaginer mon avenir.» Vivant dans une région occupée et n’ayant aucune expérience militaire, Egor indique ne pas avoir été contraint de s’enrôler. Ni de rester. Le 16 avril, il atterrit à Genève. Quelque temps plus tard, il trouve une place dans cet appartement, à Neuchâtel.
Enraciné dans la culture slave
Malgré l’espoir d’un lendemain helvète, le passé ukrainien du jeune homme perdure au quotidien. À commencer par la religion. Son enfance, Egor l’a passée entre l’école orthodoxe la semaine et l’église le dimanche. Il croit en Dieu et souhaite préserver la part de tradition que cela implique. «C’est difficile. À Neuchâtel, la seule église orthodoxe est roumaine, pas ukrainienne.» Il essaie néanmoins de s’y rendre de temps à autre.
Un rapport au passé maintenu aussi par l’activité sportive. «Quand j’ai eu 10 ans, mon père m’a emmené sur le ring. La boxe est un sport très populaire chez nous.» Une décennie et demie plus tard, Egor s’entraîne toujours. À peine arrivé à Neuchâtel, il s’est rendu dans un centre sportif réputé. «Plusieurs sports de combat sont proposés, mais mon choix reste le même. Car j’en fait depuis tout petit.» Il sourit. La boxe, un sport qui rattache sûrement le présent suisse au passé ukrainien par l’habitude des entraînements. Une activité qui rétablit peut-être aussi un lien au père par l’exercice de ce qui a été transmis. Egor s’entraîne du lundi au vendredi.
Enfin, c’est un amour patriotique défiguré par la culpabilité du non-soldat qui empêche Egor de réellement couper le cordon avec l’Ukraine. Plusieurs connaissances combattent sur le front en ce moment même. Deux amis proches sont tombés au champ d’honneur. Le sourire timide laisse place à un visage sombre. «Quand j’aurai des enfants et qu’ils me demanderont ce que j’ai fait pendant la guerre, qu’est-ce que je leur dirai?» Egor a choisi de partir de Crimée, puis de rester en Suisse. Pourtant, cette obsession du devoir patriotique persiste et l’obsède. «J’y pense tout le temps.»
La barrière de la langue
Egor ne parle que très peu français. Afin d’obtenir une autorisation de séjour plus longue, il compte trouver un emploi, pourquoi pas dans l’horlogerie. Et bien que l’anglais soit une béquille efficace, la maîtrise du français reste primordiale. D’abord pour travailler. Pour sociabiliser, ensuite. «Et pour les filles.» Il retrouve son sourire emprunté. L’aspirant francophone prend des cours depuis qu’il est arrivé ici, quatre fois par semaine. «Je trouve le rythme très intensif. Mais si je veux rester, je dois m’accrocher.»
«No french», donc Egor use d’autres vecteurs d’insertion sociale. Le sport d’une part: pour son coach François, le boxeur amateur fait preuve de résilience, tant sur le ring qu’en dehors. «C’est quelqu’un de profondément gentil, travailleur et à l’écoute. Il a du courage.» Ses colocataires Luca et Charles d’autre part, car Egor se joint à leurs activités dès que l’occasion se présente. «On a toujours parlé en anglais, raconte Luca. D’abord timide, il s’est peu à peu ouvert. C’était au début provisoire. C’est maintenant un ami.»
C’est donc un jeune homme qui n’a pas totalement coupé le cordon avec sa patrie, avec son histoire. Pourtant, s’il garde une part importante d’Ukrainien en lui, Egor reste clair sur ses projets actuels. «Peut-être qu’un jour je reviendrai en Crimée, j’y pense beaucoup. Mais pour l’instant, je dois apprendre votre langue.» Apprendre le français, chercher un emploi, développer ses relations sociales. Pour pouvoir espérer rester le plus longtemps possible en Suisse, et y vivre. Sans oublier qu’à 18 heures, c’est boxe.
Par Thomas Strübin
Ce travail journalistique a été réalisé pour le cours “Atelier presse”, dont l’enseignement est dispensé collaboration avec le CFJM, dans le cadre du master en journalisme de l’Académie du journalisme et des médias (AJM) de l’Université de Neuchâtel.